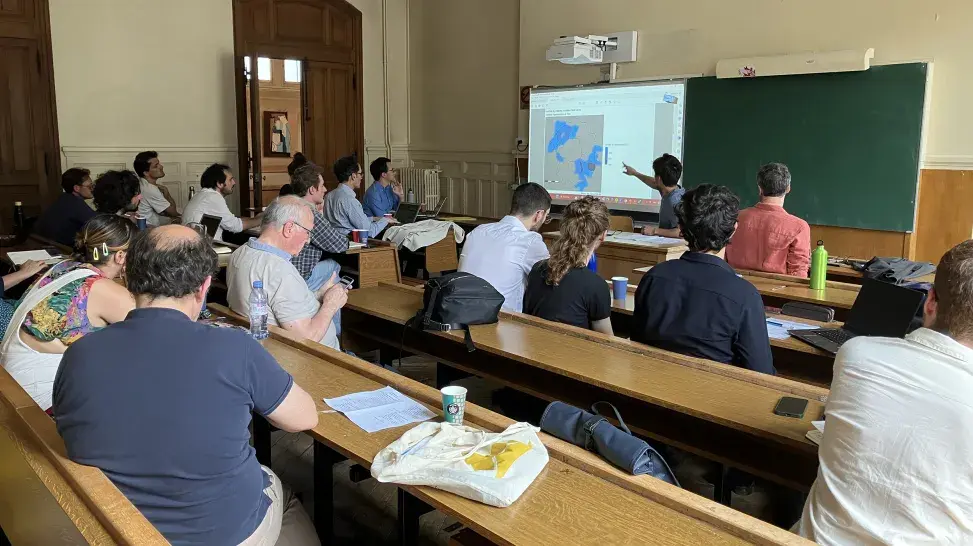Santé et environnement : le progrès à tout prix ?
Retour sur la journée d’étude « Le progrès à tout prix. Façonner l’environnement, XIXe-XXe siècles » organisée dans le cadre du séminaire « Santé et environnement » de l’université Paris 1 Panthéon-Sorbonne. Un événement scientifique né du travail collectif et collaboratif d’un groupe d’étudiants et de jeunes chercheurs et chercheuses de l’École d'histoire de la Sorbonne, du Centre d'histoire sociale des mondes contemporains (CHS/UMR 8058) et de l’Institut d'histoire moderne et contemporaine (IHMC/UMR 8066).
Apprendre à devenir chercheur
L'organisation d'une manifestation scientifique est l’une des activités clés d'une structure de recherche. Elle participe à la production, à la valorisation et au rayonnement scientifique. Devenir chercheur passe donc par l’apprentissage des différents aspects scientifiques et organisationnels d’une journée d’étude : de la réflexion sur le sujet à traiter, à la rédaction et la diffusion de l’appel à communication, en passant par l’élaboration d’un dossier de financement, et sans oublier les aspects logistiques et la promotion de l’événement. C’est à ces différentes tâches que se sont attelés les jeunes chercheurs tout au long du second semestre afin mettre sur pied leur journée de recherche, sous la supervision bienveillante de leurs enseignants Charles-François Mathis et Judith Rainhorn et grâce aux crédits attribués par la CFVU au titre des innovations pédagogiques.
Ce travail collectif s’est donc concrétisé par la tenue de la journée d’étude le vendredi 30 juin 2023 au centre Panthéon, devant un public venu nombreux. Une belle réussite pour les membres du comité scientifique et d’organisation : Gabriel Christmann, Théo Daudon, Jeanne Deville, Ilayda Fidan, Clément Fontanarava, Romain Mainieri, Pierre-Louis Poyau et Silvio Rinaudo. Les communications des huit jeunes chercheurs et chercheuses ont été complétées par les interventions de Pierre Charbonnier, philosophe, chargé de recherche CNRS à Sciences Po, Anaël Marrec, chercheuse postdoctorale au CHS et au Labex Dynamite, Renaud Bécot, maître de conférences à Sciences Po Grenoble, Alexis Vrignon, maître de conférences à l’université d’Orléans et François Jarrige, maître de conférences à l’Université de Bourgogne. Ces historiens et philosophe de l’environnement participent à ce champ très dynamique des sciences humaines et sociales, ils ont été sollicités par les organisateurs pour discuter leurs travaux et les mettre en perspective avec les études environnementales contemporaines.
Une histoire environnementale des XIXe et XXe siècles
La thématique de la journée d’étude était centrée sur le rapport entre l’histoire environnementale et la santé au cours des XIXe et XXe siècles. Elle a abordé, en fil rouge, l’idée de « progrès » qui s’est imposée au tournant du XIXe siècle dans le contexte de la « révolution industrielle » par l’influence d’acteurs économiques et d’industriels puissants poussés par l’industrialisation et les innovations scientifiques (chimie, métallurgie, plus tard électricité). Une industrialisation qui va entraîner une augmentation considérable des pollutions auxquelles seront exposées les populations, en premier lieu les ouvriers dans leur environnement de travail.
Au travers de cette thématique, les jeunes chercheurs et chercheuses ont choisi d’analyser la manière dont ce « progrès » se matérialise par le biais des transformations paysagères et sanitaires qu’il induit, et à quels imaginaires il donne naissance. En étudiant la manière dont l’environnement a été façonné tout au long des XIXe et XXe siècles à partir de situations concrètes et d’études de cas, ils ont souhaité montrer les bénéfices, mais surtout les coûts de ce qui a été qualifié comme un « progrès » souhaitable pour nos sociétés et étudier les voix qui se sont élevées contre lui.
La journée était organisée en trois sessions. La première, consacrée aux « instruments du progrès », a vu l’analyse de Pierre-Louis Poyau sur la transformation et l’amélioration de la nature dans le discours des floriculteurs français entre 1850 et 1914. Ilayda Fidan et Silvio Rinaudo ont dépeint les espaces et environnements façonnés et influencés par les empires coloniaux, dans les entrepôts de charbon d'Istanbul (1870-1914) et dans le cadre du chemin de fer transindochinois (1886-1936). La deuxième session était centrée sur « Le progrès et ses dommages ». L’intervention de Gabriel Christmann a mis en exergue « Les mains sales du progrès » en présentant le coût physique de l’extraction du charbon pour les mineurs lensois. Jeanne Deville a quant à elle abordé la question de la négation des maladies professionnelles dans les mines de la Loire dans l’entre-deux-guerres. Pour clôturer cette session, Théo Daudon a analysé le coût social et monétaire de la crue de la Seine à Paris en 1910. Enfin, la contestation était au cœur de la troisième session, intitulée « Se débattre avec le progrès », avec les interventions de Romain Mainieri, sur les conflits entre industriels et maraîchers au XIXe siècle à Lyon, et celle de Clément Fontanarava sur la dénonciation des pollutions pétrolières par les pêcheurs de l’étang de Berre en 1936.
En écho aux propos introductifs du philosophe Pierre Charbonnier, qui avait invité les jeunes chercheurs à se questionner sur la validité de la notion de « progrès », l’historien François Jarrige, qui s’intéresse notamment à l’histoire de l'industrialisation et de ses impacts sociaux et écologiques, a conclu la journée en félicitant ces « jeunes pousses » de l’histoire environnementale en les encourageant à poursuivre les pistes esquissées au cours de cette manifestation scientifique. Il a notamment insisté sur l’importance de prendre en compte les différenciations sociales et les rapports de pouvoir pour comprendre comment et par qui le « progrès » est défini. Il convient aussi selon lui de faire renaître certaines conceptions passées du progrès qui ont été balayées, oubliées, dissimulées.
Témoignage des étudiants et étudiantes sur leur expérience vécue
Nous avons particulièrement apprécié construire cette journée d’étude dans ses moindres détails, sous les conseils bienveillants de nos deux enseignants, Charles-François Mathis et Judith Rainhorn. Ce séminaire fut une occasion de compléter la "traditionnelle" formation au métier d'historien que nous suivons tous à différents niveaux : de la familiarisation avec un objet de recherche, à l'immanquable rédaction d'un ouvrage présentant le travail accompli.
Ce séminaire, sortant de ce processus solitaire par bien des aspects, nous a permis d'aborder en collectif les ressorts techniques et pratiques qui rythment également la vie de la recherche, ressorts moins connus, sinon moins reconnus. L'organisation de l'évènement nous a en effet fait passer par toutes les étapes, de l'emploi du budget à la prise de contact avec les discutants, tout en abordant les aspects plus scientifiques sous un jour nouveau et pratique (formulation du thème de la journée, rédaction d'un appel à communications). Cela a été pour nous tous l’occasion d’expériences et de responsabilités nouvelles.
La journée d'étude elle-même a finalement été le lieu de précieux échanges formels et informels entre chercheurs posant pour tous de nouveaux jalons. L’occasion peut être d'expérimenter, pour nous étudiantes et étudiants, et vraisemblablement de réaffirmer, qu'on ne fait pas de recherche en histoire seul !
Le séminaire « Santé et environnement »
Lancé à l’initiative de Judith Rainhorn, ce séminaire, co-animé avec Charles-François Mathis, a cherché, tout au long du deuxième semestre, à former des étudiants de master et de doctorat en histoire contemporaine à l’organisation d’une journée d’étude portant sur une thématique qui traverse leurs travaux respectifs. Chaque séance a été l’occasion de travailler sur une étape de la construction de la journée : réflexion tous azimuts sur un objet transversal, mise en place d’une plateforme collaborative, rédaction par petits groupes d’un appel à communications, sollicitation des intervenants et discutants extérieurs, organisation du programme scientifique, gestion des aspects pratiques (financement, transport, restauration, réservation de salle), diffusion de l’information auprès des publics concernés, etc. Ce séminaire avait pour objet de former les étudiants et étudiantes à la « fabrique » d’une manifestation scientifique par l’expérience pratique.