
RESIST : une recherche collaborative pour contrer les stratégies « anti-genre » en Europe
Le projet européen RESIST analyse les discours, les mobilisations et les politiques « anti-genre » qui mettent en péril l’égalité et la diversité sexuelle et de genre, ainsi que la légitimité des savoirs critiques. En 2024, deux études ont été produites par l’équipe transdisciplinaire, composée de chercheurs et chercheuses de dix universités européennes, dont Paris 1 Panthéon-Sorbonne.
Démarré en 2022, RESIST est un projet collaboratif soutenu par les conseils de recherche et les organismes de financement de l’Union européenne (EU Horizon Europe), du Royaume-Uni (UK Government Horizon Europe Guarantee Scheme) et de la Suisse (Swiss State Secretariat for Education, Research and Innovation) pour une durée de 4 ans. Il est coordonné par le Collège universitaire de Dublin (UCD) en collaboration avec l’Université Napier d’Édimbourg, l’Université européenne Viadrina, l’université Paris 1 Panthéon-Sorbonne, La Haute école spécialisée de Lucerne, l’Université de Lausanne, l’Université de Fribourg, l’Université Maynooth, l’Université Pompeu Fabra et le Centre de recherche féministe autonome d’Athènes.
Mettre en lumière les effets des discours, mouvements et politiques « anti-genre »
Bien que le terme « anti-genre » soit rarement employé dans le langage courant, il fait référence à un ensemble de discours, de mobilisations et de politiques visant à limiter, voir à restreindre, les libertés, ainsi que les politiques de reconnaissance et d’égalité en matière de genre et de sexualité. Ces mouvements ciblent à la fois les personnes LGBTIQ+, les féministes, les chercheurs et chercheuses travaillant sur les questions de genre et de sexualité, les journalistes, les activistes. Selon les chercheurs et chercheuses de RESIST, ces discours sont multiples et traversent le spectre politique. Ils se manifestent différemment selon les contextes nationaux au Sud, à l’Est ou à l’Ouest de l’Europe. Le projet RESIST consiste dans un premier temps à cartographier la manière dont ces discours, mobilisations et politiques sont produits et exprimés ; dans un second temps à analyser leurs effets sur les vies des personnes ciblées ainsi que les résistances qu’elles mettent en œuvre ; dans un troisième temps à coordonner une recherche collaborative autour de ces stratégies, et enfin à produire des ressources et des outils théoriques.
Plus largement, les chercheurs et chercheuses souhaitent offrir une base de connaissances solide, ainsi que des outils utiles et pertinents, aux organisations et groupes communautaires, aux décideurs politiques et aux autorités locales, « ainsi qu’à toutes celles et tous ceux qui cherchent à produire un changement réel au sein et au-delà des sociétés européennes contemporaines » précise le collectif composé de géographes, de politistes, de philosophes et de sociologues, toutes et tous spécialistes des questions de genre et de sexualité.
L’université Paris 1 Panthéon-Sorbonne est fortement impliquée dans le projet par le biais de Marianne Blidon, maîtresse de conférences HDR à l’Institut de démographie et référente égalité de l’université entre 2022 et 2024. Spécialiste des questions de genre et de sexualité, Marianne Blidon a contribué à légitimer ce champ en France, notamment en créant avec un collectif de chercheuses et chercheurs la revue Genre, sexualité et société ainsi que le certificat d'études genre de l’université qui a préfiguré le master Études sur le genre.

Étape 1 : cartographier
Entre 2022 et 2023, les chercheurs et chercheuses ont cartographié la façon dont les politiques « anti-genre » sont produites et exprimées en Europe. Publiés en avril 2024, les résultats de cette étude montrent comment les droits des personnes trans* et la défense des personnes LGBTQI+ sont devenus des cibles privilégiées des discours, politiques et mobilisations « anti-genre » à l’échelle internationale.
Cette étude est la première étude transnationale à fournir une comparaison approfondie des controverses parlementaires, médiatiques et publiques. Elle est basée sur l’analyse de milliers de débats parlementaires, d’articles de presse et de messages issus des réseaux sociaux provenant de Hongrie, de Pologne, de Suisse, du Royaume-Uni et du Parlement européen et couvrant la période de 2015 à 2022. Menée par le département d’études médias de l’université́ de Maynooth (Irlande), l’analyse s’est appuyée sur des techniques de cartographie des controverses pour examiner les explosions intensives de discours « anti-genre » dans ces pays.
La recherche met en évidence plusieurs tendances alarmantes dans la manière dont les droits des femmes et des personnes LGBTQI+ sont actuellement mis à mal. Elle dessine les contours d’un paysage politique marqué par une agitation idéologique « anti-genre » caractérisé par un opportunisme politique et une focalisation changeante sur des cibles et des enjeux interchangeables. Elle souligne aussi la persistance des attaques contre l’égalité et la diversité sexuelle et de genre, transformées par de nouveaux discours et pratiques émergents. Elle montre ainsi l’importance de prendre en compte la circulation transnationale des idées, les alliances politiques inédites, les stratégies de controverse et la concurrence médiatique qui façonnent la rhétorique « anti-genre » actuelle.
> Consulter la première étude intitulée Reports – Stage 1: Map sur le site internet du projet. Elle est composée de plusieurs rapports et d’études de cas disponibles dans différentes langues.
Étape 2 : écouter
En 2024, l’équipe RESIST a travaillé pour mieux comprendre les effets des discours, politiques et mobilisations « anti-genre » sur les vies quotidiennes des personnes ciblées, ainsi que les formes de résistance qu’elles mettent en œuvre pour y faire face. Leur analyse s'appuie sur des données qualitatives recueillies lors de 104 entretiens et 36 groupes de discussion, conduits entre janvier et mai 2024, auprès de 254 personnes, parmi lesquelles des universitaires, des journalistes, des militantes et militants. Neuf études de cas ont été réalisées comprenant la Biélorussie, un groupe de personnes vivant en exil en Europe, la France, l’Allemagne, la Grèce, l’Irlande, la Pologne, l’Espagne (Catalogne et Pays basque) et la Suisse.
Publié en octobre 2024, ce second rapport montre que, dans toutes les études de cas, y compris dans les sociétés perçues comme « progressistes », les féministes et les personnes LGBTIQ+ subissent un large éventail de préjudices allant des injures dans l’espace public au harcèlement en ligne en passant par les atteintes aux biens ou aux personnes. Ces actes redoublent parfois des discriminations et des violences systémiques. Pour le collectif, « ces violences contribuent à leur marginalisation. Leur reconnaissance est limitée par des obstacles juridiques et administratifs, aggravés par un manque de soutien institutionnel. Les discours et les mobilisations anti-genre sont ainsi de plus en plus institutionnalisées, renforcées par des discours médiatiques et politiques polarisants ».
Le rapport révèle également que les mobilisations anti-genre ont des effets significatifs sur les personnes ou les groupes ciblés : « Cela inclut des effets préjudiciables à la santé mentale et physique. Plusieurs personnes ont partagé leur sentiment de vulnérabilité, ainsi que les conséquences sur leur vie quotidienne telles que la peur, l'épuisement et l'anxiété. Ces effets sont particulièrement graves pour les personnes dont les identités marginalisées se recoupent et qui sont confrontées à d’autres formes de discriminations, y compris au sein même des collectifs LGBTIQ+ et féministes qui devraient les soutenir. Malgré ces défis, les personnes ciblées résistent en se mobilisant collectivement, en créant des espaces plus sûrs et en sensibilisant le public ».
> Consulter la deuxième étude intitulée Reports – Stage 2: Listen
Étape 3 : collaborer
La troisième étape du projet RESIST va consister en l’organisation de plusieurs ateliers dans les pays étudiés. Les chercheurs et chercheuses vont réunir 40 collectifs et organisations féministes et/ou queer dans le but de générer une recherche collaborative sur les stratégies existantes, afin de contrer les politiques « anti-genre » et de former la base d'une stratégie coordonnée. Pour le collectif, il s’agit également « de réévaluer les théories et les modèles académiques existants et d’élaborer des concepts et des outils pour répondre à ces menaces antidémocratiques ».
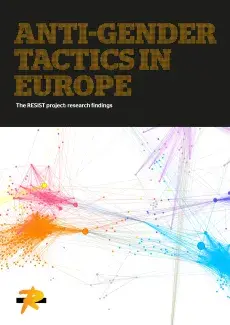
RESIST - Fostering Queer Feminist Intersectional Resistances against Transnational Anti-Gender Politics. Période prévisionnelle du projet : 2022-2026
- Présentation synthétique du projet RESIST sur le site internet de la recherche à Paris 1 Panthéon-Sorbonne : Initiatives transdisciplinaires
- Site internet du projet : https://theresistproject.eu
- Rapports et synthèses de recherches
- Espace de dépôt en libre accès du projet : Zenodo repository
- À lire : « Un rapport alerte sur l’offensive antigenre en Europe », Mediapart, 5 juin 2024 (lecture réservée aux abonné.es)
-----
Crédits photo de couverture : Michal Franczak / unsplash