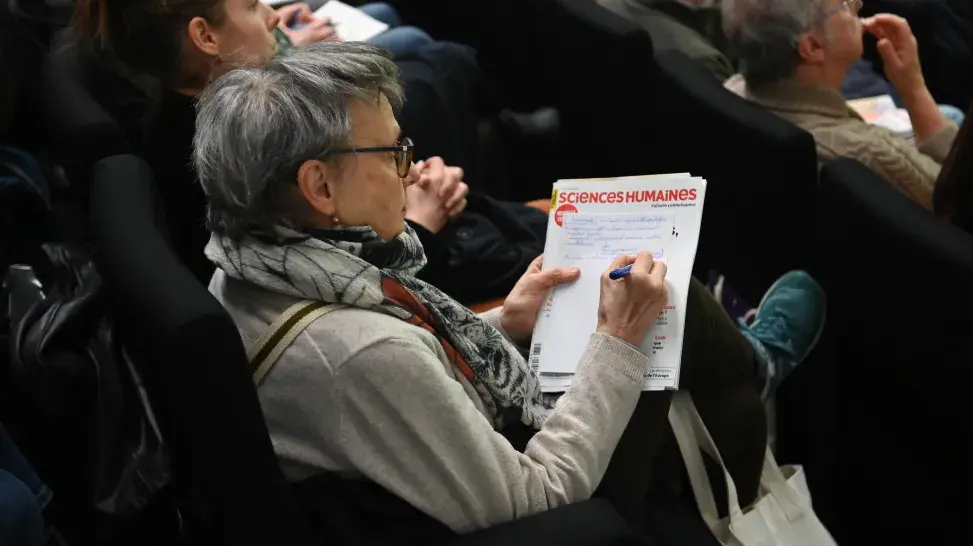Printemps des humanités : appréhender les universels
Pour sa deuxième édition, le Printemps des Humanités a rassemblé 3000 participants sur le Campus Condorcet. Trois jours de débats, de réflexions et de festivités sur le thème « universel(s) ? »
Festival intergénérationnel, interculturel et gratuit, le Printemps des Humanités articule sa programmation autour de rencontres, de tables rondes, de grands entretiens et de restitutions de recherche-création, le tout ponctué de propositions artistiques et culturelles. Cette année encore, l’événement a tenu son rôle de passerelle entre les sciences humaines et sociales et la société en faisant dialoguer au cœur du campus d’Aubervilliers, la critique, la réflexivité et l’expertise pour contribuer au débat public.
Un espace d’échanges intellectuels, artistiques et citoyens
Pas moins de 43 événements scientifiques et culturels se sont succédé durant trois jours. Un événement que Pierre-Paul Zalio, président du Campus Condorcet, a souhaité être « la somme finie de toutes les différences du monde », en citant le romancier Édouard Glissant. Un message d’ouverture en écho à la thématique « universel(s) ? » choisie cette année par le Conseil Scientifique du campus afin « d’appréhender les fractures d’un monde divisé, au prisme de réflexions scientifiques et ouvertes, et contribuer ainsi à l’édification d’un monde commun ».
Le festival a été inauguré par une conférence de Philippe Descola, dans laquelle le chercheur a développé sa pensée sur la comparaison anthropologique. Pour lui, l’anthropologie occupe une place très particulière dans les sciences sociales, du fait de son rapport ambigu à l’universel : « L’anthropologie déploie son effet critique en nous faisant découvrir d’autres manières de vivre la condition humaine et en éveillant en nous la potentialité d’être humain d’une manière dont nous ignorerions l’existence. Plutôt que d’universaliser par des lois causales, l’anthropologie altérise notre condition en la relativisant. L’un des paradoxes de cette altérisation, est qu’elle est généralement obtenue au moyen de la comparaison ». Dans son exposé, le professeur émérite au Collège de France a exploré les différentes manières d’aborder la comparaison de manière symétrique, « en s’efforçant de rendre comparables, sur un pied d’égalité, les caractéristiques culturelles de l’observateur et celles de l’observé ».
La programmation éclectique du festival a permis d'appréhender ces « universel(s) » à partir d'une multiplicité de regards issus des sciences humaines et sociales, de la culture et des arts. Les sujets de réflexions ont été nombreux et variés, allant des études décoloniales, aux sciences du religieux ou la philosophie, en passant par l’interculturalité, la fin de vie, les nomades de Zagros, le patrimoine universel de Gaza, ou la représentation politique et citoyenne des personnes exilées en France. Ces multiples activités ont largement fait place au dialogue entre les savoirs et les expériences sociales, en rassemblant chercheurs et chercheuses, étudiants et étudiantes, lycéens et lycéennes, acteurs publics, professionnels et associatifs, artistes, curieux et curieuses.
Le rôle du juge dans l’humanisation du droit international
Le projet « Bâtisseurs d’un droit commun », développé à l’Institut des sciences juridique et philosophique de la Sorbonne, comporte six vidéos témoignages de personnes dont le parcours professionnel et/ou personnel fait référence à la notion de droit commun. La vidéo diffusée lors du Printemps des Humanités est une interview du juge Antonio A. Cançado Trintade : tournée avant son décès en 2022, elle n’avait jamais été projetée jusqu’à présent.
Linxin He, professeur de droit privé à l’Université de Strasbourg et Françoise Tulkens, professeure émérite à l’Université catholique de Louvain et ancienne juge à la Cour européenne des droits de l’homme, ont pris part à un débat animé par Camila Perruso, maîtresse de conférences à l’université Montpellier 3 qui avait interviewé le juge Trintade. Figure incontournable du droit international, il a été le premier sud-américain élu successivement à la Cour internationale des droits de l’homme puis à la Cour internationale de justice, avec le plus grand nombre de voix de l’histoire. Pendant tout son parcours, le juge Trintade a été un véritable bâtisseur du droit commun, rappelant toujours la nécessité de mettre en place un droit international au service des êtres humains et non des états. Les intervenants et intervenantes ont insisté sur cette conception du droit international et sur l’importance des cours internationales qui permettent de donner la parole aux individus.
Gaza, un patrimoine universel
Proposée par les membres du projet « Gaza, inventaire d’un patrimoine bombardé », soutenu par Paris 1 Panthéon-Sorbonne, cette table ronde avait pour but d’évoquer les enjeux mémoriels de préservation du patrimoine, notamment en contexte de conflits armés. Elias Sanbar, ancien ambassadeur et délégué permanent de la Palestine auprès de l’Unesco et René Elter, archéologue, coordinateur scientifique du programme Intiqâl et directeur du programme scientifique et de préservation du monastère de Saint-Hilarion à Gaza, ont échangé en leurs qualités de spécialistes de la question du patrimoine matériel et immatériel palestinien. Modérée par Véronique Bontemps, anthropologue et responsable du séminaire « Palestine » de l’EHESS, la discussion a débuté sur l’inscription difficile de sites palestiniens au patrimoine mondial de l’Unesco et des questions que cela soulève. La lutte pour la protection et la conservation du patrimoine palestinien a rencontré de nombreux obstacles à l’échelle internationale. Pourtant, la Palestine possède un patrimoine résolument universel. Elias Sanbar a insisté sur la pluralité et la richesse de son patrimoine, « la Palestine est riche de ses strates historiques, au carrefour de toutes les civilisations d’Orient ». Ainsi, les initiatives pour la préservation du patrimoine palestinien sont indispensables. Dans le cadre du programme Intiqâl, l’ONG Première Urgence Internationale et l’École biblique et archéologique française de Jérusalem ont mis en place des formations sur les différents métiers du patrimoine, afin de permettre aux jeunes de comprendre la dimension essentielle du patrimoine qui est le leur. Visites de sites archéologiques, fouilles, restauration d’objets, autant d’activités essentielles qui sont aujourd’hui ralenties voire arrêtées à cause de la guerre. René Elter, coordinateur de ce projet, a diffusé de nombreuses photos des différents sites souvent totalement détruits, avant et après les bombardements. Le site du monastère de Saint-Hilarion, à ce jour encore épargné, a été inscrit au patrimoine mondial de l’Unesco et sur la liste du patrimoine mondial de l’humanité en péril, au mois de juillet 2024.
En lien avec cette table ronde, un atelier participatif a été animé par Marie Chominot, historienne, chargée de production des expositions à l’Institut du monde arabe. Le public était invité à reconstituer un fragment de la mosaïque du monastère de Saint Hilarion datant du VIe siècle, exhumée par la mission archéologique palestino-française, dans une des salles annexes du monastère. Le fragment de la mosaïque dite au « semis d’hederae » représente un médaillon comprenant un vase décoré à deux anses, entouré de motifs de feuilles de lierre. La mosaïque finalisée sera scellée au cours du mois d’avril sur le Campus Condorcet.
Le festival reviendra au printemps 2026 pour une nouvelle édition, autour de la question « Pourquoi travailler ? ».
Vidéos
- (Re)voir la conférence de Philippe Descola
- Retour en images sur l'édition 2025
- Table ronde "Gaza, patrimoine universel" : Intervention de Véronique BONTEMPS, anthropologue, responsable du séminaire « Palestine » de l’EHESS
- Table ronde "Gaza, patrimoine universel" : Intervention de Elias SANBAR, ancien ambassadeur et délégué permanent de la Palestine auprès de l’UNESCO
- Table ronde "Gaza, patrimoine universel" : Intervention de René ELTER, archéologue, coordinateur scientifique du programme Intiqâl pour l’ONG Première Urgence internationale, directeur du programme scientifique et de préservation du monastère de Saint-Hilarion à Gaza
- Table ronde "Gaza, patrimoine universel" : Questions de la salle