
Parution de l’ouvrage « 1937-1947 La guerre-monde » en traduction chinoise
Cette version en langue chinoise de l’ouvrage dirigé par Alya Aglan et Robert Frank, professeurs d’histoire contemporaine à Paris 1 Panthéon-Sorbonne, sort 10 ans après sa première parution en France.
L’événement a quelque chose d’exceptionnel, car il s’agit de près de 2500 pages, en deux volumes, qui rassemblent les signatures d’une quarantaine d’historiens, politistes et philosophes internationaux (Allemands, Autrichiens, Italiens, Britanniques, Canadiens) de plusieurs générations.
Après sa première édition en France en 2015 Gallimard (Folio), et après deux traductions en italien chez Einaudi (2016 et 2018), l’ouvrage collectif vient donc d’être publié en chinois par China Social Sciences Press, grâce aux professeurs LIU Jiafeng et SUN Yiping et à Christina Wu, maître de conférences à Paris 1 Panthéon-Sorbonne, qui a relu la version en chinois.
De l’embrasement à la guerre absolue
L’ambition initiale des chercheurs et chercheuses était de rompre avec une vision traditionnellement cloisonnée, essentiellement politico-militaire. Intégrer les dimensions et dynamiques sociales, économiques et culturelles dans une approche globale et locale obligeait au contraire à élargir la séquence à l’échelle de la décennie. Décentrer et multiplier les regards permettait de percevoir cette grande conflagration comme une « guerre-monde », dotée de nouvelles temporalités faisant émerger d’autres espaces.
La notion de « guerre-monde » est inspirée de « l’économie-monde », expression forgée par Fernand Braudel qui a remarqué qu’à partir des XVe et XVIe siècles, les différentes économies-mondes ont tendu à devenir une seule économie-monde, intégrées les unes aux autres pour former un « monde en soi » défini par l’économie1. De même les conflits des années 1930 se sont progressivement soudés dans une unité organique à l’échelle planétaire pour façonner une guerre-monde, un monde de guerres, qui, en quelques années, donne lieu à la totalisation de la guerre absolue.
Ainsi, plusieurs caractéristiques donnent son visage à la « guerre-monde » que cet ouvrage - là est son originalité - met en perspective historique. Il s’agit en premier lieu d’une guerre totalement « mondiale » contrairement à la Grande Guerre de 1914-1918 qui épargne certains continents. Paradoxalement, cette guerre-monde n’a pas été immédiatement mondiale mais prend l’aspect d’un monde de plusieurs guerres étroitement connectées entre elles parce que des empires coloniaux (France, Grande-Bretagne) s’y engagent contre des projets de domination impériale à vocation mondiale (nazisme, fascisme japonais). Elle devient ensuite un monde d’une seule guerre à partir de décembre 1941, lorsque l’attaque japonaise sur la base américaine de Pearl Harbor contraint les États-Unis à entrer dans la mêlée, servant de trait d’union entre le Pacifique et l’Atlantique au point d’unifier tous les conflits en cours. Ce processus de mondialisation fait converger des guerres inachevées : les guerres de Mandchourie de 1931, d’Éthiopie de 1935-1936, d’Espagne de 1936-1939, la guerre sino-japonaise débutée en 1937, la courte guerre entre l’URSS et le Japon de mai à septembre 1939. Celle qui oppose la France et la Grande-Bretagne au Troisième Reich en 1939-1940 – rejoint par l’Italie en juin 1940 – laisse la Grande-Bretagne seule à l’été 1940. L’URSS, attaquée par les armées d’Hitler en juin 1941, rompt l’isolement britannique en se tournant vers le camp allié.
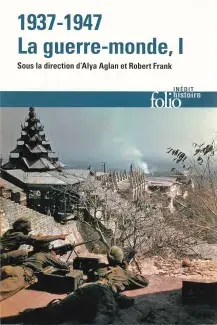
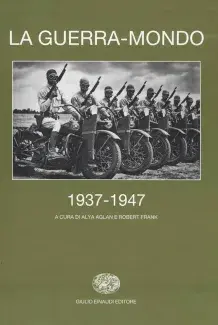
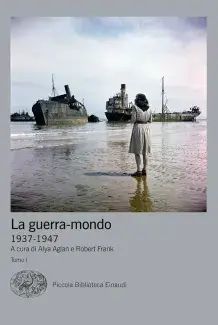
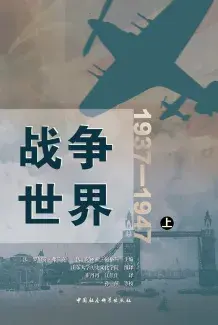
Une guerre mondialisée
En 1937 s’ouvre donc, des deux côtés de la planète, des conflits qui entrent en coalescence. Malgré la neutralité des États-Unis, le président Franklin Roosevelt réclame dans son discours de Chicago du 5 octobre, au moment de l’attaque japonaise sur la Chine, après l’incident du pont Marco Polo du 7 juillet 1937, la mise en « quarantaine » des nations responsables des invasions en violation du droit international, afin de prévenir la propagation de cette « maladie » contagieuse de violences et d’agressions saisissant le monde.
Ce processus de mondialisation de la guerre modifie les catégories temporelles et spatiales. Le temps du monde tour à tour se ramasse ou se dilate au gré des accélérations des événements ou, au contraire, de l’attente insupportable des libérations. L’espace mondial semble se rétrécir. L’expansionnisme allemand et japonais rapprochent les cinq ou six continents – l’Europe, l’Asie, l’Afrique, l’Amérique, l’Océanie et même l’Antarctique – en faisant converger leurs destins dans une conflagration générale qui prend des accents de guerre de masse où les techniques prennent une place inédite, où la radio réduit les distances, où les déplacements de combattants et de populations sont spectaculaires : des milliers de Norvégiens, de Danois, de Belges, de Néerlandais, de Français, de Polonais, de Tchèques affluent à Londres en 1940 pour en faire la capitale politique et culturelle du monde, sans compter les centaines de milliers d’Américains et de Canadiens qui affluent en Angleterre en 1944 avant de débarquer en Normandie. La guerre frappe à la porte de l’Australie qui mobilise 900 000 hommes tandis que près de 2,5 millions d’Indiens se battent dans l’armée britannique sur de nombreux fronts, des centaines de milliers d’Africains du nord forment l’essentiel de l’armée française en Italie, des millions de soldats allemands arpentent l’Europe de la Bretagne à la Russie, ainsi que l’Afrique du nord, de même qu’une masse de soldats japonais occupent la gigantesque « sphère de coprospérité asiatique » de la Chine à la Birmanie, de l’Indochine à l’Indonésie, ainsi que des Philippines aux îles Marshall. Grande aussi est la confusion spatiale entre les « fronts militaires » et « l’arrière », contrairement à la guerre de 1914-1918 qui distinguait encore ces deux espaces et qui a compté nettement moins de victimes civiles.
Enfin, la guerre crée un monde en soi en même temps qu’elle le transforme complètement. Les idées, les concepts, les représentations et les sentiments du temps de paix sont bousculés. Des comportements imprévisibles poussent des pacifistes à renoncer à la paix pour s’engager dans la résistance alors que certains nationalistes, naguère bellicistes, se convertissent au contraire à la paix en collaborant avec l’ennemi.
Un monde en mutation
Dans ces temps où les économies, les sociétés, les esprits, la science et les technologies sont mobilisés dans leur totalité, le désarroi frappe les individus. Le statut social des femmes et des jeunes subit des métamorphoses. Les violences de masse sont extrêmes, perpétrées par les Allemands et les Japonais sur les prisonniers, les populations civiles, et illustrées par le crime absolu « la solution finale », projet nazi d’extermination des juifs d’Europe. Les viols de guerre, comme ceux commis par les Japonais en Chine et en Corée ou par les Soviétiques en Allemagne en 1945, atteignent des proportions inédites. Les colonisés, mobilisés par les colonisateurs, prennent conscience de la nécessité de leur émancipation au point d’amorcer la fin des empires coloniaux. Les littératures changent de mots, les musiques changent de notes et de rythmes, soit pour galvaniser les soldats au front soit pour faire danser les couples et leur faire oublier, l’espace d’un instant, les événements dramatiques. Les nuits deviennent des éléments de la guerre : nuits de combats dans le désert comme la « nuit fantastique de Bir Hakeim » de juin 1942, nuits d’angoisse sous les bombardements terrifiants à Londres, Coventry, Dresde, Tokyo, nuits de divertissements et d’ivresse nécessaire pour supporter la guerre. Émergent, dans les déclarations officielles comme dans les écrits clandestins, une soif d’avenir meilleur préparé par les planifications de l’après-guerre : plus de justice sociale et le respect de la dignité humaine, un monde délivré de la faim et de la peur, telles sont les aspirations les plus communément répandues.
Ce sont toutes ces mutations que ce livre entend décrire et analyser en une cinquantaine de chapitres, de même qu’il s’attache à la maturation du nouvel ordre mondial sous l’égide des « Nations Unies » qui échouent à construire une « paix-monde ». Si l’année 1947 semble clore la séquence avec des traités de paix, elle inaugure de nouveaux affrontements entre anciens Alliés alors que la guerre froide, mondiale, a déjà commencé.
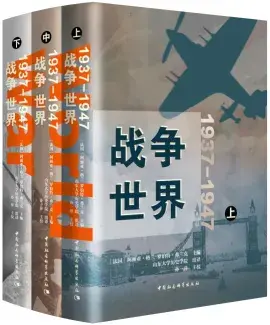
1937-1947 : la guerre-monde
Collectif, dir. Alya Aglan & Robert Frank
Vol. 1 Jean-Baptiste Bruneau, Tal Bruttmann, Masha Cerovic, Johann Chapoutot, Olivier Compagnon, Jörg Echternkamp, Antoine Fleury, Olivier Forcade, Olivia Gomolinski, Pierre Grosser, Eric Jennings, Pierre Journoud, Barbara Lambauer, Henry Laurens, Camille Lefebvre, Jérôme de Lespinois, Peter Lieb, Bernard Lory, Stefan Martens, Marie-Anne Matard-Bonucci, Jenny Raflik, Hugues Tertrais, Enzo Traverso et de Nicolas Vaicbourdt.
Vol. 2 Claire Andrieu, Ludivine Bantigny, Joanna Bourke, Johann Chapoutot, Yann Decorzant, Michel Fabréguet, Olivier Feiertarg, Gilles Ferragu, Anaïs Fléchet, Peter Gaida, Laurent Jeanpierre, Dzovinar Kévonian, Barbara Lambauer, Rebecca Manley, Michel Margairaz, Jean-Louis Margolin, Kenneth Moure, Pap Ndiaye, Jean-Sébastien Noël, Valéry Pratt, Claire Sanderson, Pierre Singaravélou.
Collection Folio histoire, 2 vol. (no244 et 245), Gallimard, première édition 2015
Trad. italien (Guilio Einaudi editor) 2016 & 2018
Trad. chinois (China Social Sciences Press 中国社会科学出版社) 2025.
1 : Fernand Braudel, Civilisation matérielle, économie et capitalisme, XVe-XVIIIe siècle, tome III, Le Temps du monde, Paris, Armand Colin, 1967.