
Ce que dit la science des attentats du 13 novembre 2015
L’exposition "13 novembre 2015 : que dit la science des attentats ?", visible à la Cité des sciences et de l’industrie jusqu’en mars 2026, présente quatre enquêtes sur les travaux de recherche menés à la suite des attaques terroristes de 2015, dont ceux du Programme 13-Novembre porté par l’université Paris 1 Panthéon-Sorbonne, le CNRS et l’Inserm.
L’inauguration de l’exposition s’est tenue le 23 septembre 2025 dans l’espace d’exposition “Science Actualités” de la Cité des sciences et de l’industrie. Elle a été suivie d’une conférence sur le thème "Attentats 2015 : quels effets sur l’individu et la société ?".
Cinq jours après les attentats de 2015, des chercheurs et chercheuses se sont mobilisés à la suite de l’appel à projets “Attentat Recherche” lancé par le CNRS. De nombreuses études ont été réalisées et dix ans après, des résultats peuvent être partagés. Cette exposition montre le rôle clé de la recherche dans diverses disciplines, qui a permis de produire des savoirs et des analyses sur un sujet aussi difficile que les attentats. Les sciences humaines et sociales ont notamment été au cœur de nombreux projets de recherche : "La Cité des sciences et de l’industrie doit plus que jamais être ancrée dans l’actualité et au plus proche des préoccupations de l’époque […] et doit se faire l’écho de toutes les sciences y compris les sciences humaines et sociales" a rappelé Delphine Samsoen, présidente par intérim d’Universcience.


Mieux comprendre les résultats de la recherche
Dans le cadre des dix ans des attentats du 13 novembre 2015, l’idée était de réfléchir à ce qu’il reste de ces événements, de montrer les avancées de la recherche et de se demander : comment partager tout cela au grand public ? C’est dans cette optique qu’a été créée l’exposition. Non seulement elle met à disposition des publics les résultats de la recherche mais elle les aide aussi à comprendre ces résultats. À travers quatre thématiques, l’exposition reprend les méthodes et objectifs de travail des scientifiques, sous différents angles.
La première enquête "Attentats : la Recherche se mobilise" se concentre sur les différents programmes mis en place après l’appel du CNRS comme le Programme 13-novembre porté par Paris 1 Panthéon-Sorbonne, le CNRS et l’Inserm. La deuxième "Post trauma, mieux comprendre pour mieux soigner" s’intéresse aux progrès en psychologie et médecine pour améliorer la prise en charge des traumatismes du trouble du stress post-traumatique. La troisième "La société française face aux attentats" porte sur les impacts sociaux des attentats et sur le rôle des sciences humaines et sociales pour éclairer les réactions sociales face au terrorisme, et pour aider à mieux y faire face. Enfin la dernière enquête "L’antiterrorisme au prisme des sciences sociales" explore les réponses et dispositifs mis en place après les attentats au prisme des sciences humaines et sociales.
Un mur de brèves complète les enquêtes. Il présente des textes courts, des chiffres, des images en lien avec les résultats scientifiques et recherches menées sur les attentats.
Un film, d’une durée de 20 minutes, présente des interviews de victimes, de parents de victimes, de membres des associations "Life for Paris" et "13onze15. Fraternité et Vérité" et de scientifiques, dont Denis Peschanski et Francis Eustache coresponsables du Programme 13-novembre. Tous deux reviennent sur la mise en place de ce programme transdisciplinaire sous la forme d’une étude longitudinale de la mémoire pendant 12 ans. Les coresponsables ainsi que d’autres membres du projet font un focus sur deux des études du Programme 13-novembre : l’Étude 1000 et l’Étude Remember.
"Transformer la terreur en connaissance et faire avancer la recherche" Pierre Gagnepain
Lors de la conférence qui a suivi l’inauguration, Pierre Gagnepain, neuroscientifique à l’Inserm, responsable de l’Étude Remember (Programme 13-Novembre) et Gérôme Truc, sociologue au CNRS, ont questionné le lien entre mémoire et science. Les deux scientifiques ont exposé leurs analyses issues de recherches menées à la suite d’attentats, la première au prisme des neurosciences et la seconde au prisme des sciences humaines et sociales.
"Résilience et oubli, que disent les neurosciences ?"
Dans son intervention, Pierre Gagnepain a exposé quelques résultats de ses recherches sur le trouble du stress post-traumatique (TSPT) et sur la mise en place de protocoles expérimentaux afin de mieux comprendre par des observations renouvelées en 2016, 2018 et 2022 les impacts et les phénomènes liés à ce trouble ainsi que les mécanismes de résilience. Le TSPT a tendance à se manifester par des images intrusives, images effrayantes liées au traumatisme. Grâce aux études menées par Pierre Gagnepain et son équipe, un lien a pu être établi entre le phénomène d’oubli et le TPST. Le protocole de recherche de l’Étude Remember qui se déroule sur deux journées à Caen, au Pôle de Formation et de Recherche en Santé, comprend des séquences en IRM (imagerie par résonance magnétique) réalisées grâce à la plateforme d’imagerie médicale Cyceron. Ces séquences incluent des personnes exposées aux attentats du 13 novembre 2015 et des personnes non exposées dit "groupe contrôle" auxquelles sont proposées le test "Think / No think". L’objectif de ce test pour le sujet inclus est d’apprendre au préalable des "paires" associant un mot à une image neutre et de les mémoriser (exemple : le mot "bateau" et l’image "maison"). Ensuite, dans l’IRM, si le sujet inclus voit s’afficher un mot en vert, il a pour mission de "laisser venir", de penser à l’image associée ; si un mot s’affiche en rouge, l’image associée est alors à considérer comme intrusive, et il doit essayer de repousser cette image, d’oublier l’image "intrusive". Ces exercices permettent aux chercheurs d’observer les différences d’activation des différentes régions du cerveau selon la consigne donnée. L’oubli est alors lié à un mécanisme de contrôle inhibiteur. Les personnes ne souffrant pas de trouble du stress post-traumatique parviennent bien plus facilement à oublier, et donc à mettre en place ce mécanisme de contrôle, que les personnes atteintes de TSPT.
C’est ainsi que l’équipe a déduit que le phénomène d’oubli de l’image intrusive traduit par ce mécanisme de contrôle, pouvait limiter les effets du stress et donc aider le TSPT à diminuer, voire disparaître. Grâce à cette expérience, les personnes atteintes de TSPT ont entraîné leurs fonctions cérébrales et cognitives à "oublier" et les résultats montrent qu’un certain nombre d’entre elles ont vu leur trouble réduire et sont, dans certains cas, devenues résilientes. Néanmoins, de nombreux progrès sont encore à faire pour tenter de comprendre les mécanismes neurobiologiques de l’oubli. En conclusion Pierre Gagnepain a rappelé le message de son intervention : "oublier ce n’est pas nier la mémoire, au contraire il faut se souvenir pour oublier".
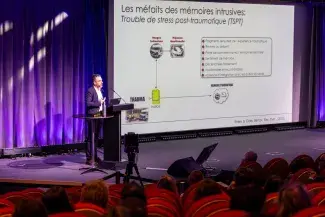
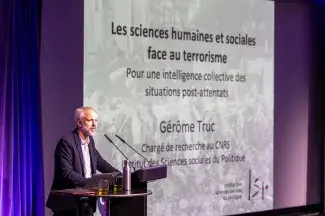
"Les sciences humaines et sociales face au terrorisme : pour une intelligence collective des situations post attentats"
En partant d’un article publié par le sociologue américain Randal Collins, Gérôme Truc a commencé par exposer les différentes avancées scientifiques des sciences sociales ces dernières années sur les réactions et les impacts sociaux des attentats terroristes. Ce que le chercheur appelle "la réaction sociale" face aux attentats se caractérise par quatre phases, pour reprendre le schéma de Collins. La première est la phase du choc, elle est rapide et survient après les attentats. La seconde est la phase de réponse collective, sous la forme de soutiens, de symboles ou encore de rassemblements. La troisième est la plus importante car c’est aussi plus longue, on peut la qualifier de phase d' "hystérie". La société traverse un moment d’effervescence et d’agitation et se retrouve davantage vulnérable. Elle dure généralement six à huit mois avant la quatrième phase de retour à la normale. En 2015 et 2016, la France donc vécu une succession de ces processus qu’aucun autre pays en Occident n’a connu : les attentats de janvier 2015, près de dix mois plus tard les attentats du 13 novembre 2015 et huit mois plus tard les attentats de juillet 2016. Gérôme Truc a insisté sur les différents mécanismes qui se mettent en place dans cette troisième phase, qui à la fois renforcent la cohésion sociale et la solidarité, exacerbent les tensions, sont propices à de nouvelles attaques, suscitent une panique infondée et de fausses alertes, ou encore amènent du racisme. Collecter des données sur ces élans de solidarité a permis au sociologue de comprendre de quoi procède ce renforcement de cohésion sociale post-attentat. Que se passe-t-il quand une personne fait preuve d’un élan de solidarité ? D’où parle-t-elle ? Qu’emploie-t-elle comme moyens ? Ces connaissances scientifiques vont permettre d’éviter à l’avenir certains pièges des périodes post-attentat. L’attentat terroriste est une mise à l’épreuve du corps social et l’intelligence collective est essentielle pour la surmonter.
L’exposition "13 novembre 2015 : que dit la science des attentats ? " est visible à la Cité des sciences et de l’industrie jusqu’au 22 mars 2026. Toutes les infos ici.
Dans le cadre des 10 ans post-attentats, plusieurs manifestations scientifiques ou grand public seront organisées au cours du dernier trimestre 2025 en lien avec le Programme 13-Novembre.
MANIFESTATIONS SCIENTIFIQUES :
Colloque : "La mémoire du 13 novembre 2015 : un enjeu citoyen" organisé par l’association 13onze15 : Fraternité et Vérité, le mardi 4 novembre 2025
Inscription gratuite mais obligatoire, en présentiel (places limitées) et en visioconférence
Conférence dans le cadre du festival Art(s) et justice : "Faire mémoire, faire recherche" organisée par l’Université de Lorraine, Cinéma KLUB le mardi 18 novembre 2025
PUBLICATIONS :
Abécédaire du 13 Novembre. La Terreur en toutes lettres dirigé par Catherine Brun aux éditions Hermann.
La charge mémorielle. Une approche genrée de la mémoire du 13-Novembre de Charlotte Lacoste aux éditions Hermann
Faire face. Les Français et les attentats du 13 novembre 2015 de Francis Eustache, Sandra Hoibian, Carine Klein Peschanski, Jörg Müller et Denis Peschanski aux éditions Flammarion.
DOCUMENTAIRE :
"13 novembre. Nos vies en éclats" produit par l’INA (Institut National de l’Audiovisuel).
Constitué d’extraits de témoignages issus des trois phases (2016 ; 2018 ; 2021-22) de l’Étude 1000 du Programme 13-Novembre, ce documentaire de 90 minutes, écrit et réalisé par Valérie Manns (productrice : Valérie Abita), sera diffusé :
- le lundi 3 novembre à 23h20 sur France 2 ;
- le vendredi 14 novembre à 14h40 sur France 5 ;
- en replay sur https://www.france.tv/
--------------------
Le Programme 13-Novembre (Paris 1 Panthéon-Sorbonne, CNRS, Inserm et 21 partenaires ainsi que 20 unités de recherche) bénéfice d’une aide de l’État gérée par l’Agence nationale de la Recherche au titre de France 2030 portant la référence ANR-10-EQPX-0021.